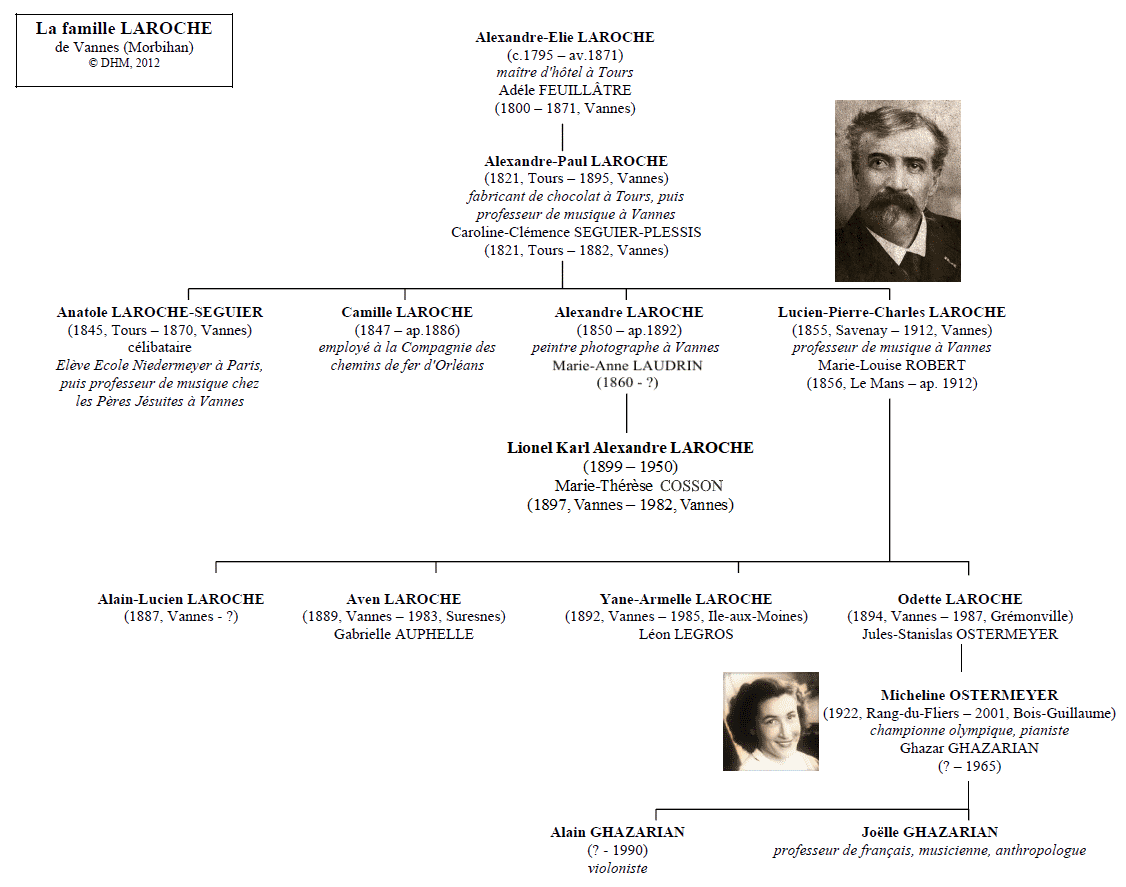mythée Laroche
(1897 – 1982)
Marie-Thérèse
Laroche, surnommée « Mythée », est née Cosson le 29 décembre 1897 à
Vannes. Après
avoir entamé des études de piano au Conservatoire de sa ville natale auprès de
Lucien Laroche (3ème médaille en 1910), elle alla se perfectionner à
Paris avec Alfred Cortot. Revenue à Vannes, elle y enseigna toute sa vie le
piano et épousa en 1922 un neveu de son 1er professeur Lucien
Laroche : Lionel Karl Alexandre Laroche, né le 27 octobre 1899 à Vannes,
violoniste et professeur de musique, fils d’Alexandre Clément Laroche, peintre
et photographe, et de Marie-Anne Laudrin. Décédée le 9 juin 1982 à Vannes, elle
avait perdu son mari quelque 32 ans plus tôt (le 27 octobre 1950), dont elle était divorcée depuis janvier 1924.
[Sur la famille Cosson, voir généalogie établie par Eric Gourlaouen]
Parmi ses nombreux élèves, on note le nom du chanteur, acteur, producteur et compositeur Claude-Michel Schönberg (né le 6 juillet 1944 à Vannes), auquel on doit notamment la musique de l'opéra rock "La Révolution française" (1973) et des comédies musicales "Les Misérables" (1978), "Martin Guerre" (1996), "Marguerite" (2008), "Cléopatra" (2011)... ainsi que de plusieurs chansons à succès pour Mireille Mathieu, la chanteuse québécoise Martine Saint-Clair et le groupe « la Bande à basile ». L’un de ses plus grands triomphes est la chanson "Le Premier pas" (1974), interprétée par ses soins. Marié en 1979 à Béatrice Schönberg, actuelle journaliste et présentatrice de télévision, celle-ci, après divorce et en secondes noces, épousera en 2005 l’homme politique et ancien ministre Jean-Louis Borloo.
L’un de ses autres anciens élèves, Yann Boulanger, vannetais d’origine et préparant une étude sur la diffusion des pianos au XXème siècle en Bretagne et en particulier à Vannes, nous livre ici quelques souvenirs sur son professeur de piano.
D.H.M. (janvier 2020)
*
Elle avait gardé de son séjour parisien d’avant-guerre une élégance Chanel faite de discrétion, de classicisme et de bon goût qui contrastait avec l’allure mémé ou extravagante des demoiselles « piano » de préfecture. A cette époque, jusqu’aux années soixante, l’enseignement de la musique en province reposait généralement sur de vieilles dames dont les revers de fortune avaient favorisé la vocation souvent tardive. Elles transmettaient ainsi avec application les secrets du clavier - ou tout au moins ceux qui leur avaient été révélés - par l’intermédiaire de la méthode rose ou des ces inénarrables études dont l’objectif caché était de dégoûter les élèves.
Plus rarement, il y avait aussi de plus jeunes professeurs dont la formation était sans doute meilleure mais qui ne juraient alors que par les modernes pour bien se distinguer de la plèbe égrotante. Leurs tenues violettes, vertes et chichiteuses transpiraient de surcroît le dodécaphonisme militant de ces intellectuelles égarées chez les braves gens.
Mythée Laroche représentait dans cet univers impitoyable et contrasté une exception, une merveilleuse exception.
Elle était née à Vannes en 1897 et ses dons furent vite découverts par des parents soucieux sans doute d’avoir un enfant prodige. Là où beaucoup d’autres échouèrent, ils réussirent. C’est qu’un enfant prodige est tout autant le résultat de l’acharnement que du talent. Comme l’affirmait un spécialiste des sciences de l’éducation : « Mozart, c’est Léopold ! ». Forts de ces principes pas encore théorisés, ces parents prévenants permirent à leur fille de franchir toutes les étapes de ce grand œuvre qu’est l’apprentissage de la virtuosité.
Rien ne lui fut refusé. Les cours intensifs dont elle garda le souvenir d’une enfance un peu sacrifiée et, l’été, le transport de son cher piano à l’Île-aux-Moines où la famille passait ses vacances dans ce lieu de rêve alors largement ignoré du tourisme récent. L’instrument restait parfois une nuit ou deux sur le quai avant d’être hâlé à dos d’homme dans la propriété. Mais surtout, il fut entendu qu’elle irait à Paris pour perfectionner son art auprès d’un maître incontesté, Alfred Cortot.
C’était l’époque où l’on ne pouvait progresser que dans la capitale. Point de concerts ailleurs ou trop peu, point de disques. Point de concurrence stimulante. Les radiodiffusions balbutiantes ne pouvaient prétendre former l’oreille car la haute fidélité était loin d’être une réalité. Le monde provincial vivait alors en silence et seules quelques grandes villes pouvaient s’enorgueillir de posséder des professeurs d’un niveau suffisant pour accompagner les jeunes espoirs vers les plus hautes cimes.
Elle fut donc inscrite à ce qui allait devenir un peu plus tard l’Ecole Normale de Musique que le Maître lança juste après la première guerre mondiale. Elle reçut ainsi l’enseignement rigoureux et sévère de cette institution comme ses condisciples Magda Tagliafero et Yvonne Lefébure. Alfred Cortot rodait sa fameuse méthode rationnelle pianistique qui révolutionna la discipline et aboutit à former un jeu à la fois délicat et expressif, bref, un jeu français s’accordant si bien à cette époque patriote caractérisant également la facture des Pleyel, des Erard ou des Gaveau, devenus eux aussi symboles du génie national.
Il en fallait du courage pour absorber les exercices ingrats qui retournaient parfois les ongles. Un bol d’eau chaude était prévu à cet effet afin d’écourter l’indisponibilité des doigts. Mais au prix de cet effort, se profilait la vélocité puis la virtuosité et enfin la maîtrise du répertoire, de ce trésor tant convoité ne se livrant que peu à peu.
Le milieu parisien musical d’alors avait aussi des charmes incomparables. Mythée Laroche approcha ainsi les étoiles de la musique française de ce début de siècle. Fauré était le plus gentil. Il aimait bien les enfants tandis que Debussy paraissait bougon. Il est vrai qu’il perdit sa fille, la petite Chouchou à laquelle il dédia ses Children’s corners. Elle n’ignorait rien non plus des manies de Ravel qui collectionnait les automates et vivait en oiseau nocturne. Il corrigeait volontiers les devoirs d’harmonie des élèves du conservatoire. Etre corrigé par Ravel, quel privilège ! Elle se rappela plus tard aussi d’un enfant encore inconnu, Yehudi Menuhin.
Ses études achevées, elle se maria dans les années vingt avec un jeune violoniste qui avait partagé son enfance singulière. Le jeune et brillant couple s’apprêtait à faire carrière et commença ses tournées en Europe.
Les villes d’eau dont les casinos n’évoquaient pas encore les machines à sous bruissaient toujours de musique suave, légère ou sérieuse : les échos de Kreisler se prolongeaient dans ces palaces mondains aux cures peu contraignantes et aux plaisirs bien réels. La musique « sérieuse » également bienvenue apportait un supplément d’âme aux esprits désœuvrés qui hantaient - pour combien de temps ? - les lieux. La sonate de Franck dont on dit qu’elle avait inspiré celle de Vinteuil dans La Recherche constituait le morceau de bravoure des jeunes interprètes. Le scherzo en si bémol de Chopin revenait souvent aussi dans leurs programmes. Cette vie de nomade les obligea parfois à escalader à dos de mulet les sentiers menant à ces hôtels d’altitudes où quelques privilégiés se donnaient l’illusion de reprendre des forces tels ceux de La Montagne Magique que Thomas Mann a décrits. Leurs déambulations les menèrent à peu près partout sauf en Allemagne que leur patriotisme leur interdisait formellement
Cette vie de gloire s’acheva à la déclaration de guerre et ne reprit pas ensuite en raison de la mort du violoniste en 1950.
Mythée Laroche occupait alors l’appartement de la rue Saint-Vincent, celui de ses parents. Après leurs études parisiennes et en dehors des tournées effectuées dans les années trente, le couple n’avait jamais habité ailleurs. Etait-ce la vie itinérante ou l’absence d’enfant qui les en avaient dissuadés ? Nul ne sait. Toujours est-il que, veuve maintenant, elle ne songea plus à partir et prit dans la demeure familiale peu à peu la suite de la génération précédente.
Cette continuité d’occupation donnait le sentiment que ces lieux étaient hors du temps. Les journaux ayant obstrué les persiennes lors de la défense passive étaient toujours là dans les années soixante-dix.
L’immeuble patricien situé dans la rue Saint-Vincent qui regroupait derrière la porte des remparts la haute société de la ville avait été construit lors du repli du parlement de Bretagne à Vannes, sous Louis XIV ou peu après. Il avait subi certainement de multiples transformations mais la cage d’escalier gardait de cette époque les voûtes et les marches de pierre lui donnant une grande élégance et surtout une exquise fraîcheur l’été. Passer de la touffeur de la rue à l’ombre bienfaisante de l’entrée était un réel plaisir tout comme monter les deux étages qui n’étaient pas difficiles à gravir en raison de la pente assez douce des volées. Mythée Laroche occupait l’appartement de droite résultant de la séparation de l’étage en deux, pratique courante dans les anciennes constructions dont les surfaces et même les volumes ne correspondaient plus aux besoins des occupants, ce qui produisait parfois d’étranges agencements.
Un large couloir au plancher étincelant desservait les pièces. A gauche, une immense salle à manger garnie de meubles bretons cirés était flanquée d’une minuscule cuisine installée dans l’ancienne entrée. Une imposante porte vitrée menait au salon bénéficiant également d’une ouverture directe sur le couloir. Cette pièce était en permanence plongée dans la pénombre car ses volets étaient restés fermés depuis la guerre. Mythée Laroche protégeait ainsi les magnifiques tapisseries vertes et or qui recouvraient ses fauteuils Empire et plus généralement le mobilier d’époque, un ensemble élégant mais austère dont personne ne profitait en dehors de circonstances exceptionnelles. Ces pièces formaient avec les chambres situées dans une aile de l’immeuble la partie « privée » de l’appartement que le couloir desservait également en obliquant vers la droite. Par contre, le salon de musique, proche de l’entrée et dont la porte faisait face à celle du grand salon était le siège d’un permanent va-et-vient dû à la succession ininterrompue des leçons. Cette pièce était curieuse car elle avait été amputée par une cloison vitrée à mi-hauteur destinée à masquer le passage du couloir qui menait jusqu’aux chambres et évitait ainsi qu’elles ne fussent commandées comme cela avait été jadis le cas.
Tout y semblait donc maintenant trop haut et disproportionné. La fenêtre à petits carreaux donnant sur la cour de l’immeuble et l’immense cheminée garnie de photos augmentaient cette impression que la présence d’un imposant piano droit, d’une petite table, d’un guéridon et de deux fauteuils ne dissipait pas. Une ambiance à la fois sévère et recueillie régnait dans ce petit salon tout autant consacré au culte de la musique qu’à son étude quotidienne. Trois divinités y étaient représentées. Au-dessus du piano, dans un cadre doré, Beethoven à la mine majestueuse et renfrognée semblait guetter les fausses notes. Un biscuit de Mozart placé sur l’instrument tremblait à chaque accord. Sur une photo dédicacée avant-guerre « à ma chère Mythée », Alfred Cortot posait dans la grande tradition romantique à laquelle son inimitable chevelure longue et ses yeux un peu exorbités faisaient irrésistiblement penser.
Les papiers à fleurs au rose et bleu passé dataient des années vingt tout comme le guéridon et les petits fauteuils sur lesquels les élèves attendaient leur tour. Les quelques revues traînant sur la table auraient pu faire penser à l’antichambre d’un médecin si elles avaient eu un rapport même lointain avec l’actualité. Mais là aussi, le temps s’était suspendu et les feuilles jaunies faisaient toujours la réclame des bandages Bergougnan équipant les camions et les affûts des canons tractés de la première guerre mondiale. De magnifiques photos de manœuvres illustraient les progrès décisifs de ces productions qui concurrençaient encore les pneus.
Le grand piano droit était un Klein robuste et sonore. Ses touches jaunies et parfois recollées trahissaient l’épuisement d’un instrument condamné à jouer de nombreuses heures par jour depuis, disons, soixante ans. La mécanique fatiguée et l’accord approximatif n’aidaient malheureusement pas l’interprétation souvent hésitante des élèves. Mais malgré tout, Mythée était capable d’en sortir quelque chose lorsqu’elle leur montrait comment faire de ses mains que le travail intensif de ses jeunes années avait un peu déformées.
L’organisation de la leçon était immuable. L’élève arrivait après avoir généralement attendu et posait ses partitions sur le pupitre garni d’un grand livre d’images dessinées par Benjamin Rabier et reliées en carton dur. Sans lui, la partition aurait eu une fâcheuse tendance à s’avachir et à tomber sur le clavier aux moments les moins propices. Les exercices d’assouplissement des doigts pouvaient alors commencer. Puis les gammes « profondes », en tierces, en sixtes, les arpèges et les octaves. Après vingt minutes d’un tel régime, un rhumatisant aurait pu faire la roue. Un peu de Czerny, quelques autres études et la main était prête pour attaquer la musique proprement dite, c’est-à-dire Bach en premier lieu. Il fallait toujours travailler en parallèle le « père Bach » et un autre compositeur. Les petites inventions puis les fameux vingt-quatre préludes et fugues développaient le sens de la polyphonie, celui de l’indépendance des doigts et l’intelligence musicale des compositions complexes et savamment charpentées. Ce travail de fond inspiré de l’enseignement du Maître ignorait tout des complaisances de certains professeurs d’autrefois qui recherchaient les résultats rapides et faciles de la musique « de genre » flattant immédiatement l’orgueil des parents. Non. Il fallait gravir pas à pas les marches de la vélocité, de la virtuosité et de l’interprétation.
On arrivait enfin après presque une heure au morceau en chantier. Là encore, point d’originalité : Beethoven, Mozart, Chopin, Schubert et Schumann faisaient partie intégrante du programme. Debussy et Ravel y avaient également une grande part. Mais ce classicisme ne l’empêchait pas d’accepter les propositions de ses élèves : Bartok, Gerschwin ou autres. L’interprétation l’amenait à élargir l’horizon de sa leçon à des considérations qui n’étaient plus seulement techniques. Elle truffait alors sa conversation d’anecdotes destinées à éclairer l’œuvre ou le compositeur ou de considérations historiques, sociologiques ou même métaphysiques dont les développements grignotaient dangereusement les leçons suivantes. Ainsi, fallait-il être le premier de la matinée ou de l’après-midi pour être à peu près sûr de son heure. Mais personne ne songeait à râler car c’était bien là qu’elle se distinguait des autres en apportant toute son expérience d’ancienne concertiste, de véritable artiste qu’on devait lui envier et qui transformait pour les grands élèves du moins ses cours en « master class » sans pour autant recourir à cette pédante expression.
« Chauffe-moi ça ! » disait-elle, lorsqu’elle trouvait les forte trop timides dans les tempêtes beethovéniennes se concluant si souvent en piano éthérés comme si les enfers avaient été soudainement vaincus par les cieux. Le paradis était d’ailleurs l’une de ses préoccupations favorites. Elle s’en faisait l’image d’un lieu idyllique où chacun pouvait jouer son air sans qu’il en résultât une cacophonie, ce qui relevait bien sûr du surnaturel. Les luttes entre l’ombre et la lumière, les Florestan et Euzébius de Schumann étaient autant d’introductions à la psychologie, aux troubles de l’âme qui devaient trouver leurs traductions pianistiques appropriées malgré l’infidélité des doigts que les exercices soutenus n’avaient pas encore complètement domptés. Car, pour elle, l’expression ne résultait pas tant d’une langueur romantique - bien qu’elle s’enquît de la sensibilité de ses élèves - que d’une maîtrise parfaite de la main sans laquelle rien n’était possible. La physiologie était alors naturellement un champ d’observation inépuisable qui aurait poussé Mythée Laroche à embrasser une carrière médicale pour percer les secrets des muscles, des ligaments et de la neurobiologie, consciente que cet art vivant, celui de l’interprétation, reposait sur une parfaite coordination corporelle relevant plus du sport ou de la danse que de la rumination intellectuelle. La grande difficulté du virtuose était donc de combiner les qualités du gymnaste à celles du poète. Voilà quelques-unes des réflexions qui accompagnaient et enrichissaient son enseignement moderne aussi éloigné des mièvreries sentimentales de la plupart que des excès mécanistes des autres.
Elle séduisit ainsi des générations d’élèves se bousculant à ses cours dans un ordre approximatif car elle ignorait totalement la notion d’emploi du temps, ce qui provoquait de fréquents télescopages. On attendait donc en feuilletant les éternelles réclames du guéridon tout en écoutant ses précieux conseils.
Son désintéressement se traduisait non seulement par l’allongement des cours mais aussi par leur prix qui ne variait jamais malgré l’énorme inflation de l’époque. Elle ne vivait que pour ses élèves et continua jusqu’à un âge avancé le rythme infernal de son activité ne lui laissant pas toujours le temps de se nourrir convenablement malgré les objurgations de ses deux voisines compatissantes qui veillaient sur sa santé et lui préparaient souvent ses repas.
Elle s’éteignit rapidement et mourut le 9 juin 1982 n’ayant pas survécu à l’arrêt des leçons que ses forces déclinantes ne lui permettaient plus de donner.
En passant rue Saint-Vincent, j’entends encore mon rapide coup de sonnette puis les accords étouffés du piano et j’imagine qu’elle sait maintenant si chacun peut au paradis jouer son air sans qu’il en résulte une cacophonie.
Yann Boulanger